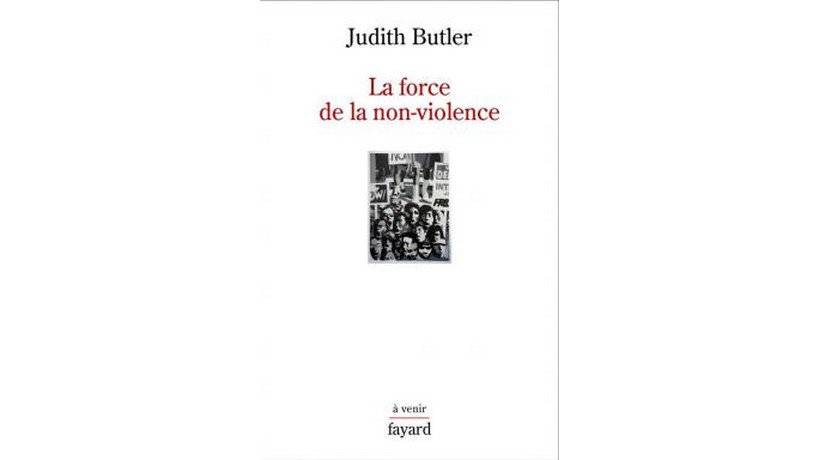Judith Butler (1956 – ) est une philosophe américaine, connue dans le monde entier pour ses travaux sur le genre. Elle est professeur à l’université Berkeley depuis 1993. Depuis plusieurs années, elle développe une réflexion qui vise à renouveler l’idéal de la non-violence. Dans son nouvel ouvrage La force de la non-violence: une obligation éthico-politique (édité en France par Fayard), elle expose sa vision éthique et politique de la non-violence et « propose de constituer la non-violence comme nouvel imaginaire politique ». Nous venons de le lire.
Judith Butler fait remarquer que « la confusion d’opinions » sur la violence et la non-violence, « termes litigieux et contestés », rend difficile toute pensée rationnelle sur la non-violence. Par voie de conséquence, elle constate d’emblée que « la défense de la non-violence suscite le scepticisme dans tout le spectre politique ». Si l’on veut défendre la non-violence, il importe, nous dit-elle, de « comprendre et d’évaluer comment la violence est représentée » et critiquer la manière dont elle est justifiée par l’Etat qui bien souvent dissimule sa propre violence tout en accusant ses opposants d’y recourir.
Avant de clarifier sa vision de la non-violence, Judith Butler met l’accent sur les liens qui unissent ceux qui sont victimes de la violence et qui s’efforcent de lui résister par la non-violence et ceux qui usent de la violence à leur encontre. « Si la personne qui pratique la non-violence est liée à celle contre qui une violence est envisagée ou commise, écrit-elle, alors il semble qu’il y ait entre elles une relation sociale préalable : elles font partie l’une de l’autre, un soi est impliqué dans un autre soi ». De ce constat, Butler en déduit que la non-violence a forcément une dimension collective, et non pas individualiste. C’est pourquoi :
une éthique de la non-violence non seulement ne peut pas être fondée sur l’individualisme, mais doit même prendre la tête d’une critique de l’individualisme comme fondement de l’éthique et de la politique. Toute éthique et toute politique de la non-violence devraient rendre compte de cette manière dont les sujets sont impliqués les uns dans la vie des autres, liés par un ensemble de relations qui peuvent être aussi salvatrices que destructrices. Les relations qui nous obligent et qui nous définissent s’étendent au-delà de la rencontre dyadique humaine, et c’est pourquoi la non-violence ne concerne pas les seules relations humaines, mais toutes les relations vivantes et interconstitutives (p. 20).
Le lien social « réel ou potentiel » qui relie deux êtres qui s’affrontent nécessite de revisiter l’approche du conflit. A l’encontre de l’idée souvent répandue, y compris dans les milieux progressistes, que la défense de soi-même ou l’auto-défense impliquent la légitimation de la violence, Judith Butler indique que « la non-violence nécessite une critique de l’éthique égologique et de l’héritage politique de l’individualisme afin d’ouvrir l’idée d’individualité comme champ périlleux de la relationnalité sociale ». Ceux qui sont au pouvoir peuvent aussi invoquer la défense de soi pour défendre par la violence les institutions qui le soutiennent et qui génèrent des injustices. Face aux menaces imaginaires ou réelles, le pouvoir est enclin à « libérer la violence qu’il s’autorise lui-même ». La non-violence bien comprise récuse l’argument de la défense de soi qui sert de justification à l’Etat pour recourir à la violence contre ses opposants.
A ceux qui considèrent que la violence est légitime pour résister à un pouvoir tyrannique ou pour « triompher de la violence structurelle et systémique », Judith Butler souligne que pour que cet argument soit valable, « il faudrait que nous sachions ce qui distingue la violence du régime en question de la violence qui cherche à l’abattre ». Elle reconnait que cette distinction est bien difficile à établir et que probablement la violence risque fort de se reproduire et de redoubler « dans des directions qui ne peuvent pas toujours être connues à l’avance ». La violence s’enferme alors dans une spirale incontrôlable où toutes les violences finissent pas être légitimées par la violence de l’autre, souvent bien au-delà de la stricte nécessité qui l’avait légitimée au départ. A ce stade, c’est la violence qui est maître du jeu, et non ses auteurs qui sont instrumentalisés.
Un autre argument de justification de la violence sur lequel Judith Butler s’interroge est celui qui consiste à dire que « la violence n’est qu’un moyen au service d’une fin ». « La violence, se demande-t-elle, peut-elle rester un simple instrument, un simple moyen pour faire cesser la violence – ses structures, son régime – sans devenir elle-même une fin en soi ? » Elle poursuit son interrogation en se demandant ce qui se passe « si la violence échappe à tout contrôle, si elle est utilisée à des fins pour lesquelles elle n’avait jamais été prévue, dépassant et défiant l’intention qui la gouvernait ». En posant ces questions de façon précise sans asséner des vérités intangibles, Butler invite les partisans de la violence à la réflexion critique. Elle poursuit : « Et si la violence était précisément le type même de phénomène qui ne cesse d’ « échapper à tout contrôle » ? Que se passe-t-il, enfin, si l’usage de la violence comme moyen d’arriver à une fin autorise, implicitement ou effectivement, un usage plus général de la violence, introduisant ainsi encore plus de violence dans le monde ? ». Saines interrogations qui préfigurent une réflexion renouvelée sur la non-violence.
Il importe donc de « stabiliser une définition de la violence » pour mieux appréhender la non-violence, d’autant que les interprétations de la violence sont multiples et variées, non consensuelles. La vie sociale étant constituée de multiples interactions entre les individus, Butler perçoit la violence comme « une attaque contre cette même interdépendance ». Cette interdépendance ne concerne pas seulement les « autres vies humaines », mais aussi « les autres créatures sensibles ». C’est pourquoi la non-violence ne peut être réduite à une « position morale », mais doit être comprise comme « une philosophie sociale des liens vivants et durables ». Elle suggère donc que la non-violence soit définie « comme une pratique sociale et politique entreprise de concert, qui culmine dans une forme de résistance aux formes systémiques de destruction et dans un engagement à bâtir un monde qui honore une interdépendance planétaire semblable à celle qui incarne les idéaux de liberté et d’égalité sociale, économique et politique ».
La non-violence est une pratique de la résistance qui devient possible, sinon obligatoire, précisément au moment où faire violence semble le plus évident et le plus justifié. En ce sens, la non-violence peut être comprise comme une pratique qui non seulement arrête un acte violent ou un processus violent, mais qui nécessite, en outre, une forme d’action soutenue, poursuivie quelquefois avec agressivité.
Judith Butler déroule sa vision de la non-violence en insistant sur le fait qu’ « elle ne vient pas nécessairement d’une région pacifique ou apaisée de l’âme » parce qu’ « elle est souvent une expression de rage, d’indignation, d’agression ». Butler reconnaît le rôle central de l’agressivité dans la manifestation de la non-violence et parle à ce propos de « non-violence agressive ». S’appuyant sur les réflexions de Gandhi sur « la force d’âme », expression d’une « force non-violente », elle explique que la force ne saurait se réduire à la force physique. Celui qui s’engage dans la non-violence en vient forcément à mettre en avant son corps face aux forces de répression et aux forces de la violence contre lesquelles il se mobilise. « Cela implique, admet-elle, une souffrance, oui, mais dans le double but de se transformer soi-même et de transformer la réalité sociale ». Ainsi, « la non-violence ne suppose pas l’absence de force ou d’agression. Elle est, pour ainsi dire, une stylisation éthique de l’incarnation dans un corps, pétrie de gestes et de modes de non-action, de manières de faire obstacle, d’utiliser la solidité du corps et son champ d’objet pro-prioceptif[1] pour bloquer ou détourner un nouvel exercice de la violence ». Toutefois, admet Judith Butler, la non-violence « n’est pas un principe absolu » car « il n’est pas de pratique de la non-violence qui ne doive négocier des ambiguïtés éthiques et politiques fondamentales ».
La non-violence est fortement liée à l’idée d’égalité en ce sens qu’elle veut prendre en compte l’ensemble des situations de vie, notamment les plus marginales, les plus rejetées par la société et le pouvoir. « Quand des mouvements non-violents oeuvrent dans le cadre de l’égalitarisme radical, c’est la demande égale d’une vie vivable et pleurable qui sert d’idéal social directeur, un idéal fondamental pour une éthique et une politique de la non-violence qui dépasse l’héritage de l’individualisme ». Ainsi,
la non-violence est moins un échec de l’action qu’une affirmation physique des exigences de la vie, une affirmation vivante, une revendication qui se fait par la parole, par le geste et par l’action, à travers des réseaux, des campements et des rassemblements qui tous essaient de redéfinir les êtres vivants comme dignes de valeur, et digne d’être pleurés, dans les conditions précisément où ils sont soit effacés du visible, soit précipités dans des formes irréversibles de précarité.
L’insistance privilégiée de la thèse de Judith Butler sur le fait que le recours à la violence implique la destruction du lien social, sur le fait qu’elle fait le tri entre les personnes qui méritent d’être défendues et celles qui ne le méritent pas, sur le fait que se défendre soi-même par la violence, c’est forcément exclure des catégories de la population qui méritent d’être défendues, renouvelle l’approche éthique et politique de la non-violence, comprise comme une force indispensable au maintien du lien social constitutif de notre dépendance aux autres. Dans cette perspective, la non-violence est une force combative et « agressive » en faveur de l’égalité des droits de tous, à commencer par le droit de vivre, ce que la violence est incapable d’assurer. « La non-violence, affirme Butler, devient une obligation éthique par laquelle nous sommes tenus précisément parce que nous sommes liés les uns aux autres ». Faire l’option de la non-violence, dans un cadre social où nous sommes en interdépendance, c’est ainsi refuser de participer à la destruction de l’autre pour ne pas se détruire soi-même.
La force de la démonstration de Judith Butler, c’est qu’elle détruit un à un tous les préjugés tenaces qui persistent à l’encontre de la non-violence, tout particulièrement ceux que l’idéologie dominante met toujours en avant pour refuser de voir sa pertinence : son inutilité, sa passivité, sa position morale et individualiste, sa faiblesse, son absence de force et d’agressivité, le fait de la considérer comme un principe absolu qui ferait fi des réalités et des nécessaires compromis. Son ouvrage, écrit parfois dans un langage un peu abscons, n’est pas un énoncé de principes, mais une succession d’interrogations démonstratives qui amènent le lecteur à déconstruire les représentations positives de la violence et celles négatives de la non-violence. L’ambition affichée en introduction de cet ouvrage de constituer la non-violence comme nouvel imaginaire politique est, selon nous, parfaitement atteinte.
1 La proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps (Encyclopédie Wikipédia).